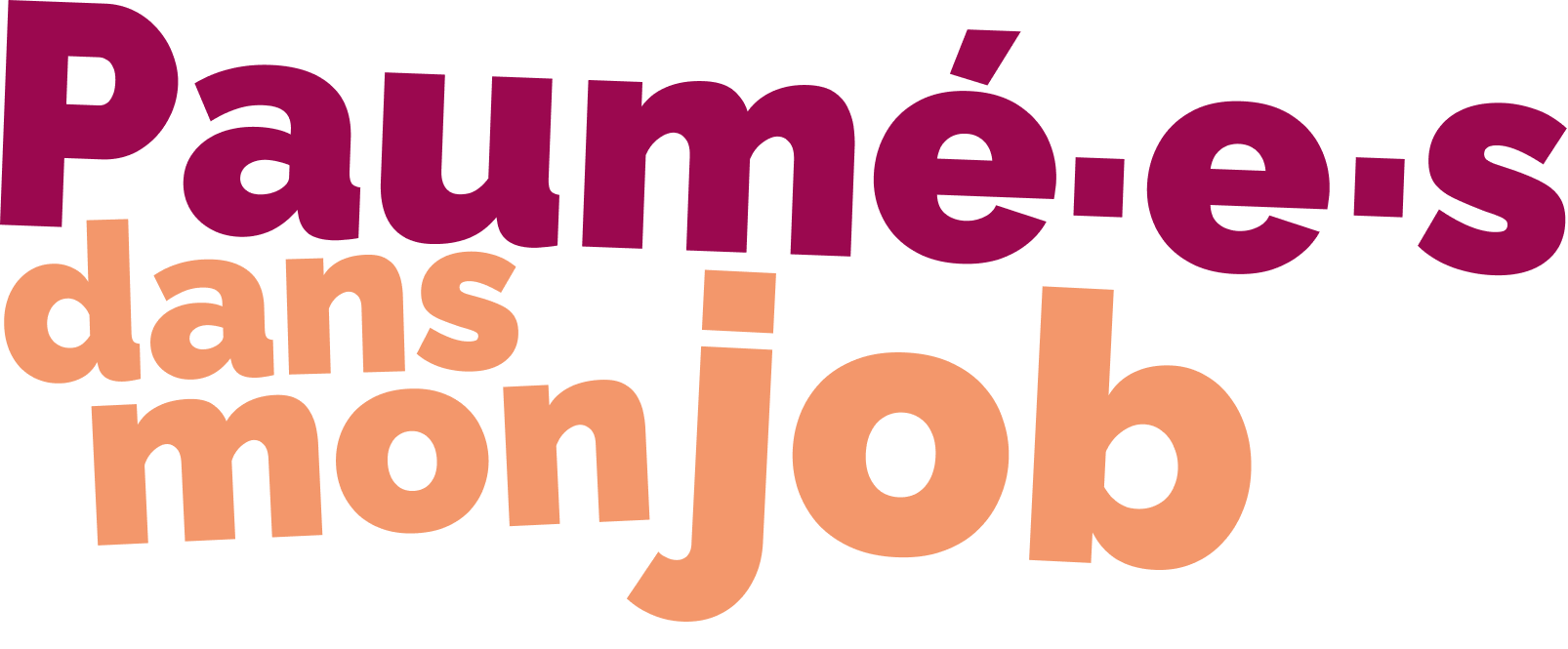C’était il y a quelques mois et une décision historique. À l’automne 2024, David Zana s’est rendu à la COP16 sur la biodiversité à Cali en Colombie. Reportage de l’intérieur au plus près des peuples autochtones.

Communauté Misak pendant la COP. Bulevar del Río, Cali. (Oscar Calambas)
Une décision “historique”.
Un coup de marteau, puis des cris de joie. C’est la grande victoire de la COP16 sur la biodiversité. Après dix années de plaidoyer, les peuples autochtones et communautés locales du monde entier auront un organe dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), à l’image de ce qui existait déjà pour le fonds vert climat. Prévu à l’article 8J de l’accord, cet organe permanent subsidiaire et doté d’une co-présidence indigène, aura l’ambition de faire porter les savoirs traditionnels des communautés jusque dans les hautes sphères du pouvoir international onusien. “Historique”, selon la ministre colombienne de l’environnement, Susana Muhamad, fière d’avoir surmonté l’opposition de pays comme l’Indonésie ou la Russie, et de laisser un tel héritage derrière elle.
“Au nom des peuples originaires de Colombie et de la MPC, la table de dialogue qui réunit les différentes organisations indigènes du pays, nous saluons cette décision”, a déclaré Carlos Gonzales, du Conseil Régional Indigène du Cauca (CRIC). Un progrès que reconnaît également Fermín Chimatani Tayori, leader indigène péruvien de la communauté Harakbu: “Après tant de luttes, c’est un pas en avant important qu’il convient de saluer et qui va permettre de construire l’avenir”.
Fermín sait que la route est encore longue avant que les peuples autochtones trouvent réellement leur place sur la scène internationale. Nombreuses sont en effet les communautés qui ne se sentent pas suffisamment impliquées dans les prises de décision et qui désapprouvent le système onusien de financement de la biodiversité, maintenu à l’identique étant donné l’absence d’accord des différents Etats parties sur la question budgétaire.

À gauche, Taita Álvaro Morales, une figure éminente de la communauté Misak et du mouvement indigène en Colombie. Son décès récent à donné lieu à de nombreux hommages. (David Zana reporter)
Des critiques envers le système de financement de la biodiversité
Lors de l’accord de Kunming-Montréal en 2022, un fonds dédié à la biodiversité (le GBFF) a été créé, dépendant du Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM), et il a été décidé que 20% des fonds iraient aux peuples autochtones et communautés locales. Mais ces derniers en contestent le fonctionnement. Ils demandent la création d’un nouveau fonds pour la biodiversité indépendant du FEM, un fonds plus favorable à leurs intérêts et qui leur permettrait d’avoir un accès plus direct aux financements. Ils reprochent au FEM d’avoir une gouvernance dominée par les pays du Nord et d’être à l’origine d’un système de financement opaque et truché d’intermédiaires. En effet, les fonds du FEM transitent par une agence de mise en œuvre, qui peut être une agence de l’ONU, une banque de développement ou une grosse ONG comme WWF ou Conservation International. Elles sont 18 au total. “Ce qui est reproché, c’est qu’elles reçoivent beaucoup d’argent dont une partie importante reste chez elles au lieu d’aller dans le pays destinataire. Elles prennent en effet à chaque fois un pourcentage de 15 ou 20%”, explique Juliette Landry, chercheuse spécialiste de la gouvernance internationale de la biodiversité à l’IDDRI.
Le parcours des fonds ne s’arrête pas là. Ils transitent ensuite par une agence nationale, une étape que les peuples autochtones souhaiteraient aussi faire supprimer. Enfin, les fonds sont surtout envoyés à des ONG, plus habiles pour monter des projets et se les faire financer. “On se sent exclus des décisions”, lamente Fermín, regrettant que les véritables acteurs soient finalement les ONG et non les communautés indigènes et locales qui habitent le territoire. Selon lui, “c’est regrettable car les communautés ont une connaissance approfondie du territoire, une vision plus pratique, et contrairement aux ONG, ne gaspilleraient pas une partie importante des fonds en coûts administratifs”.

Communauté Arhuacos dans la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie. (Diego Aretz)
Des critiques plus profondes
C’est tout le paradigme actuel que questionnent les peuples autochtones. “Dans la culture occidentale, vous savez particulariser et approfondir. Cela a ses avantages mais entre en conflit avec la vision intégrale qu’ont les indigènes. Par exemple, le fait de diviser les choses en 23 cibles et 4 objectifs comme le fait l’accord de Kunming-Montréal, n’a pas trop de sens pour nous. Les océans à part, les forêts à part, les déserts à part, etc. Vous classifiez alors que nous avons une cosmovision”, défend le leader indigène colombien Didier Chirimuscay. Spécialisé dans la conservation des aires naturelles protégées du bassin amazonien péruvien, Fermín ne cache pas non plus ses mots. Il dénonce une culture du “projet”, imposée par les bailleurs de fonds : “ils parlent plus des projets que de leurs impacts. Sans compter que les projets ont un début et une fin, alors que nous avons un plan de vie”.
Didier et Fermín se rejoignent par ailleurs pour déplorer une vision victimisante des communautés indigènes, comme s’il s’agissait de populations vulnérables qu’il fallait aider et inclure alors qu’elles demandent surtout à que leurs droits soient respectés. Didier appartient à la communauté Misak, connue pour s’attaquer aux symboles de la colonisation espagnole et son mot d’ordre “Récupérer la terre, pour récupérer tout le reste”. Il rappelle que les revendications de sa communauté ne portent pas sur l’argent mais sur le respect de leurs droits territoriaux, aujourd’hui mis à mal par les monocultures et les politiques extractivistes : “Nous demandons davantage des terres que de l’argent. Parce-que l’argent, on ignore avec quelles conditions il arrive. Si on reçoit de l’argent, on l’utilisera pour acheter des terres et protéger les écosystèmes”. Depuis Baku où il participe aux négociations de la COP sur le climat, Fermín tient aussi à rappeler que “les communautés ne doivent pas être vues comme des destinataires mais plutôt comme des associés stratégiques. Ce sont des interlocuteurs valides”.
Quelles perspectives ?
Directrice du Centre d’études latino-américaines d’Edimbourg, professeur et participant aux COP depuis des années, Soledad Garcia Ferrari a néanmoins vu dans cette COP16 des raisons d’être optimiste. Selon elle, la décision de créer un organe subsidiaire n’est pas arrivée par hasard. Elle est venue couronner, non seulement dix années de plaidoyer, mais aussi douze jours de discussions et d’échanges dans lesquels les peuples autochtones ont été au centre des attentions, une source d’espoir selon la chercheuse : “La COP16 avait ce changement de narratif qui était beau à voir, pour une fois on ne parlait pas que de chiffres mais aussi du côté humain des choses. On sentait la voix très forte de la Colombie et de l’Amérique latine, un mouvement du bas vers le haut et une relation beaucoup plus profonde avec les peuples originaires”.