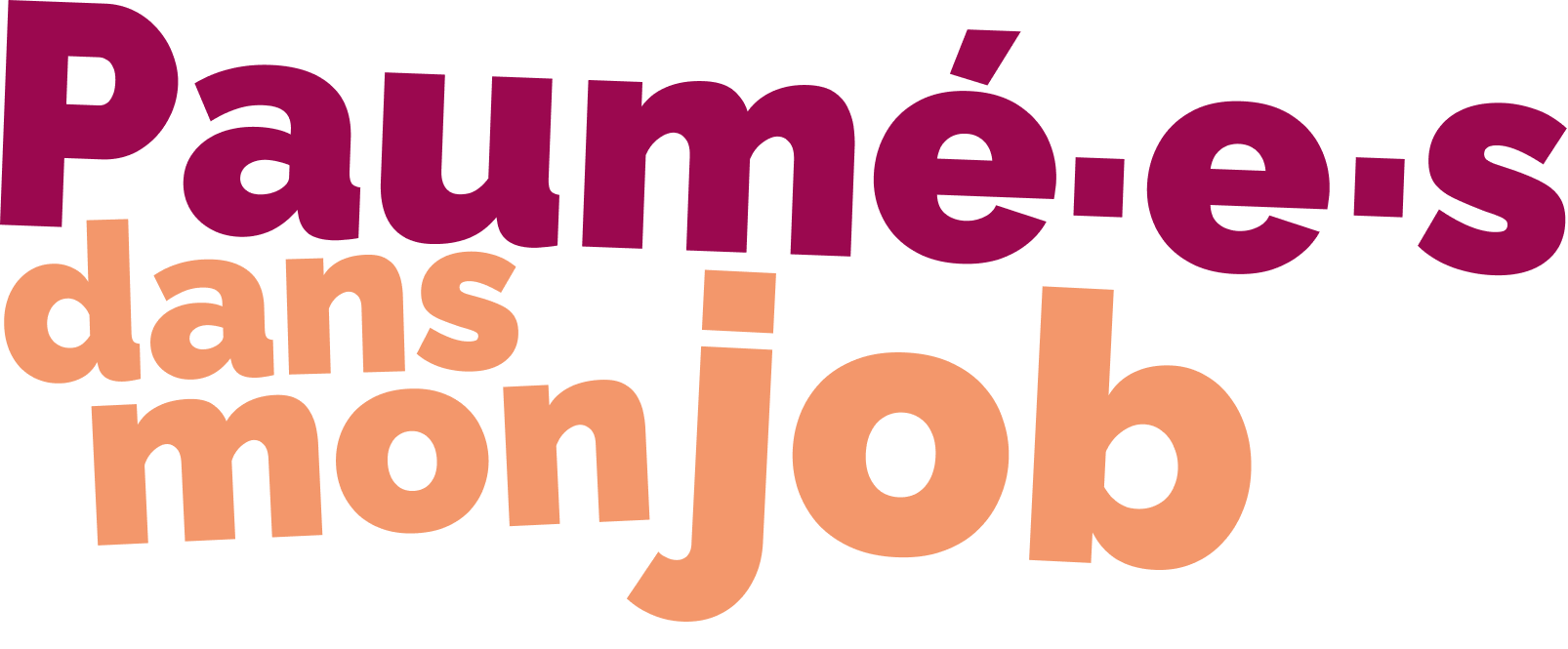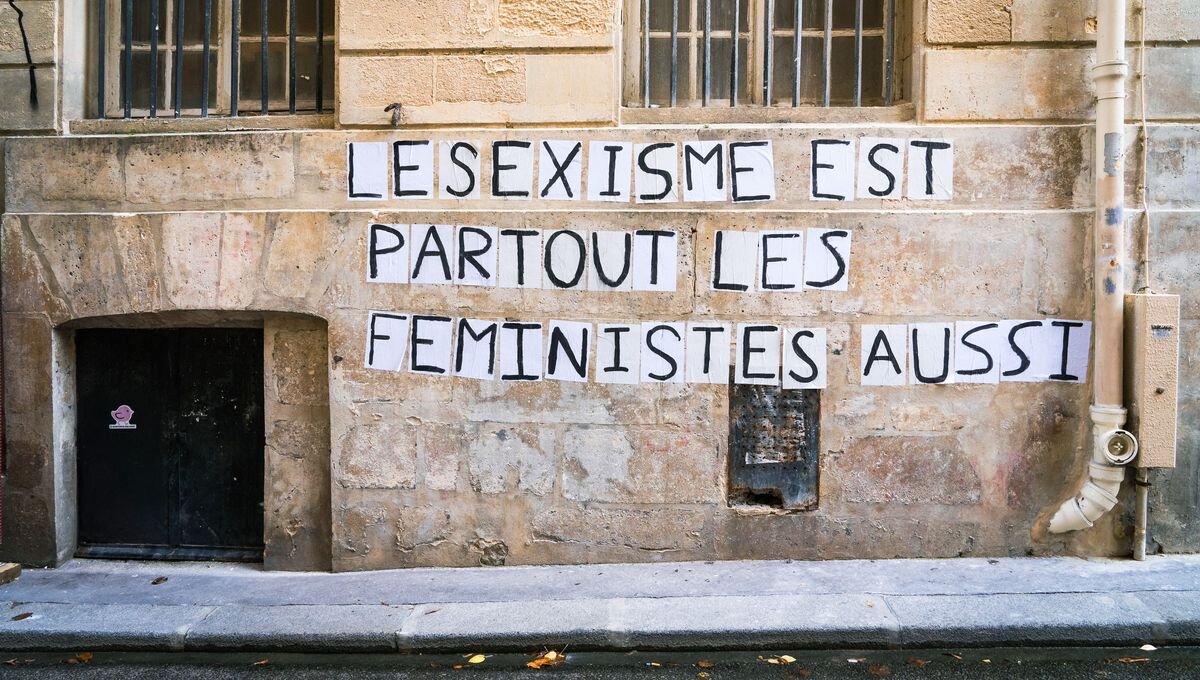Le patriarcat tout le monde connaît, parfois même un peu trop. Mais le matriarcat, ça vous parle ? Petite leçon express pas donneuse de leçons.
Entre le fromage et le dessert, tonton Dédé fait encore des siennes. Au détour de deux blagues beaufs qui mettent tout le monde mal à l’aise, un amalgame douteux au milieu d’une conversation lambda et une fâcheuse tendance à parler des femmes comme des « minettes » ou des « petites poules », il rappelle à tout le monde que « le patriarcat, ça a toujours existé partout, faut arrêter de se plaindre ». Alors déjà, c’est complètement faux (Non, rien ne prouve que ça existe depuis la nuit des temps. La preuve ici.). Ensuite, tonton Dédé, ça te parle, le « matriarcat » ?
Matriar-quoi ?
Matriarcat, tonton Dédé. Si on prend la définition la plus simple, donnée par le Robert, c’est « Un régime juridique ou social où la mère est le chef de la famille ».
Ah ouais, c’est l’inverse du « Patriarcat »?
C’est trompeur, puisqu’à une lettre près, c’est le même mot, mais... Non. C’est différent.
Contrairement au patriarcat, les sociétés matriarcales se détachent d’une image sexiste, où la femme imposerait sa loi. On ne parle pas d’ascendance de la femme sur l’homme, mais simplement d’une plus grande importance apportée aux mères.
En réalité, c’est un peu plus complexe : on parle de sociétés « matrilinéaires », ce qui signifie que la transmission se fait par la mère. Les enfants appartiennent au clan maternelle et non à celui du père.
Ce sont également des sociétés « matrilocales » : une fois marié, le couple s'installe dans la communauté ou le foyer de la mariée, et non l’inverse.
En fait, c’est plus une primauté des mères que des femmes. On pourrait donc davantage définir le matriarcat comme « Un régime juridique au sein duquel la parenté se transmet par les femmes ». Ça fait sens, quand on sait qu’étymologiquement, « matriarcat » pourrait se traduire par « mère depuis le début ».
L'oeil du dico :
Le matriarcat, c’est une organisation sociale où la mère ou les femmes occupent une place centrale. Attention, pas de confusion : ce n’est pas l’inverse du patriarcat, où une domination serait imposée.
Dans un système matriarcal, on parle de matrilinéarité (la transmission se fait par la lignée maternelle) et de matrilocalité (le foyer se centre autour de la femme). Ce régime valorise la parenté féminine et se distingue par des relations égalitaires, sans structure hiérarchique. Étymologiquement, « matriarcat » signifie littéralement « mère depuis le début ».
Pas de pouvoir absolu, mais une organisation où les mères assurent la continuité.

Communauté Juchitecas au Mexique
Et votre histoire d’égalité femme-homme ? Quand c’est dans ce sens là, ça vous dérange moins, hein !
Ok, alors tu vas commencer par vite redescendre, tonton Dédé. Là, tu te mets clairement le doigt dans l'œil. Les sociétés matriarcales sont égalitaires. On t’explique.
Les femmes n’y détiennent pas le pouvoir. La mère est certes placée au centre, mais pas au sommet. Même si les femmes gèrent le plan économique des sociétés, les décisions politiques sont prises par consensus, sans différentiation de sexe. C’est aussi pour ça qu’on ne peut pas dire que le matriarcat est l’image inversée du patriarcat : dans ces sociétés, les femmes n’ont pas besoin de structure hiérarchique.
Mais ça a vraiment existé, des sociétés centrées sur les « bonnes femmes » ?
La célèbre anthropologue et féministe française, Françoise Héritier, a dit « Le matriarcat est un mythe et le pouvoir appartient toujours aux hommes ». C’est vrai, et faux à la fois. Parce que dans cette définition là, elle considère le matriarcat comme un reflet du patriarcat, où la femme dominerait le pouvoir. Or, comme on l’a expliqué, ce n’est pas ça.
Si on base davantage la définition sur les facteurs matrilinéaires et matrilocales, ou si on considère qu’une société est matriarcale à partir du moment où l’économie est aux mains des femmes : alors oui, ça a existé. On dira même plus : ça existe toujours.
Je suis comme Saint Thomas : je ne crois que ce que je vois. On a des exemples ?
On en a même plusieurs ! Il reste quelques sociétés matriarcales sur le globe. La plus grande d’entre elles, c’est chez les Minangkabaus, en Indonésie. Là-bas, par exemple, « les biens ancestraux, notamment les maisons et les rizières, se transmettent de mère en fille ». De la même manière « Lorsqu’un homme de cette ethnie se marie, il part s’installer dans la maison de sa belle-famille ».
On retrouve également les Moso en Chine, où les Juchitán au Mexique. Dans cette dernière, les femmes travaillent beaucoup et gèrent l’économie du foyer.
C’est bien beau, mais dans le monde animal, c’est le mâle qui domine. C’est comme ça.
Une nouvelle fois, Dédé, ça ne va pas te plaire, mais... tu dis n’importe quoi. Dans le monde animal, il y a toujours eu des espèces au sein desquelles le matriarcat est le mode de fonctionnement naturel. Pour les petits animaux, comme les abeilles et les fourmis qui bossent pour une reine, ou les plus gros, comme les éléphants. Chez eux, c’est la femelle la plus âgée qui guide le groupe.
Eh oui tonton, des animaux qui mettent à mal(e) le patriarcat, il y en a des tas ! Pour en savoir plus, tu peux faire un tour du côté de notre article « Ces animaux vachement plus déconstruits que nous », d’ailleurs.
Alors tonton, d’autres questions ?
Sources :
Ce qu'il faut retenir :
Le matriarcat, ce n’est pas juste l’inverse du patriarcat. Dans les sociétés matriarcales, la mère occupe une place centrale au sein de la famille et de la filiation, mais sans que les femmes ne dominent les hommes. Ces sociétés fonctionnent sur des valeurs de coopération et de partage des rôles, plutôt que sur une hiérarchie stricte.
En Indonésie, chez les Minangkabau, ou au Mexique, chez les Juchitán, ce système social met en avant la parente maternelle comme pilier, sans pour autant exclure la contribution des hommes.
Au travers de l’histoire, le matriarcat a souvent été mal compris, vu comme une utopie ou une curiosité anthropologique. Pourtant, des études récentes, comme celles de Nadia du Basque et d’autres publications universitaires, montrent que ces systèmes existent toujours et fonctionnent.
Il est temps de tourner la page et d’imaginer un monde où la place des femmes et des hommes est enfin équilibrée, dans un cadre social où chacun peut contribuer.